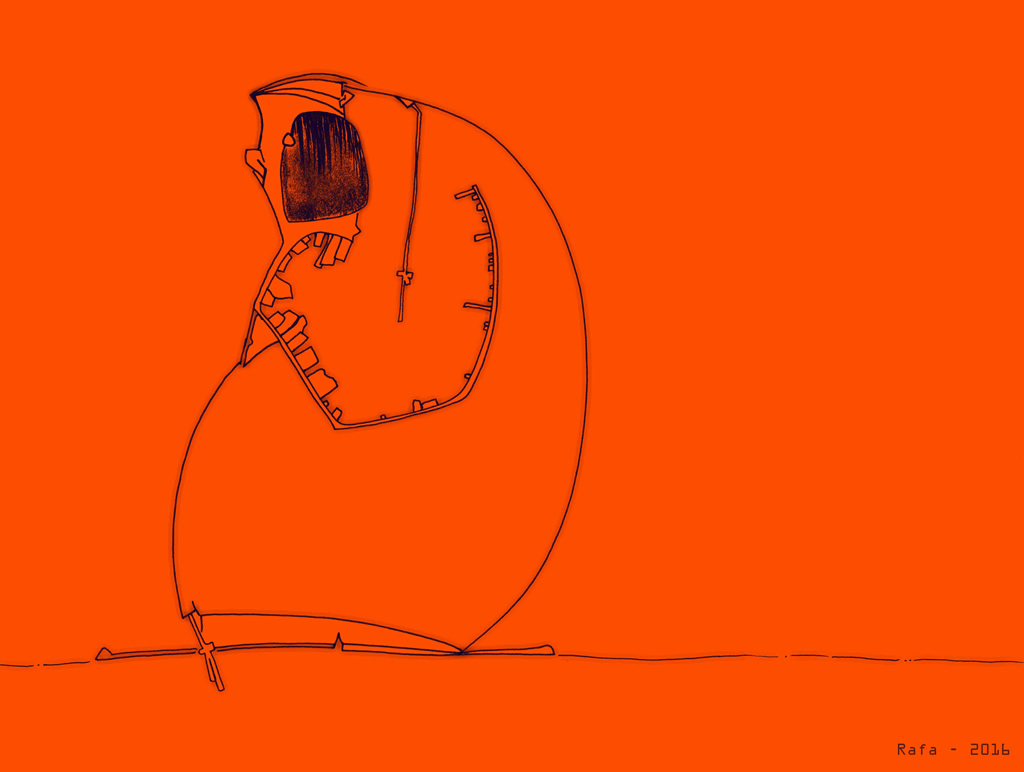|
Les défaites du mouvement social se sont accumulées ces dernières années, l’arrogance dogmatique des dirigeants politiques et des dominants en général est de plus en plus manifeste, la certitude que la seule politique à mener est celle des « réformes » néolibérales est assez largement partagée parmi les économistes du mainstream. Le néolibéralisme n’est pas mort et n’est peut-être pas près de mourir. À l’évidence, il se renforce et se radicalise. Aucune crise ne le freine. Au contraire, il se renforce au fur et à mesure des désastres qu’il engendre. C’est la triste leçon que l’on est bien obligé de tirer des années qui nous séparent du paroxysme de la grande crise de 2008. Juste après son déclenchement, un certain nombre d’observateurs ou de responsables politiques d’horizons différents avaient décrété que « le néolibéralisme était mort ». C’était par exemple le thème de l’article célèbre de Joseph Stiglitz de juillet 2008 intitulé « La fin du néolibéralisme », titre qui faisait écho au fameux texte de Keynes, « La fin du laisser faire », écrit en 1926. A quatre-vingt deux ans de distance, la critique de Stiglitz était à peu près la même : le marché laissé à lui seul conduit toujours à une mauvaise allocation des ressources, à la spéculation, à la crise. Si l’on peut être d’accord avec le constat de l’échec du néolibéralisme, on ne peut qu’être en désaccord avec la conclusion qu’en tirait Stiglitz, à savoir que le « bénéfice de la crise mondiale » consisterait dans le congé définitif donné au « fondamentalisme de marché ». On s’aperçoit aujourd’hui que la crise n’a encore apporté aucun bénéfice de ce genre et que l’on a plutôt assisté à une radicalisation des politiques néolibérales. La question est donc de savoir pourquoi la crise de 2008 n’a pas débouché sur une mise en question du néolibéralisme, comme le pensait Stiglitz, (avec beaucoup d’autres). Pour poser la question autrement, il nous faut nous demander pourquoi l’analogie avec les années 20 et 30 ne semble pas pertinente, du moins jusqu’à présent. C’est là une question majeure qui n’a pas encore été résolue.
Nous ne voulons évidemment pas en conclure à une quelconque éternité du néolibéralisme. On peut même penser que la rigidité propre au système économico-politique du néolibéralisme remet à l’agenda des sociétés l’impératif révolutionnaire bien compris, celui d’une auto-institution de la société. Il importe d’abord de nous interroger ici sur le caractère systémique du dispositif néolibéral qui rend toute inflexion des politiques menées difficile, voire impossible. En réalité, nous n’avons plus affaire seulement à des « politiques néolibérales » dans le cadre d’un régime politico-économique qui pourrait accepter des politiques différentes, par exemple sociales-démocrates au sens le plus traditionnel du terme. Nous avons affaire à un système néolibéral mondial qui ne tolère plus d’écart par rapport à un programme de transformations qui vise à le renforcer toujours plus. Ce système néolibéral nous fait entrer dans l’ère postdémocratique.
Trois interprétations de la radicalisation néolibérale
L’Europe offre depuis 2010 le spectacle particulièrement instructif de cette radicalisation néolibérale : alors que les politiques d’austérité ont démontré leur échec, elles continuent d’être imposées au prétexte qu’il n’y a aucune autre solution pour les Etats que de rembourser les dettes publiques jusqu’au dernier euro dû. Par un formidable tour de passe-passe, en confondant l’effet et la cause, « l’État surendetté » a été désigné comme le premier responsable de tous les malheurs des sociétés. Et les conséquences de l’austérité - effets récessifs massifs sur l’activité économique, faible croissance, chômage, baisse des revenus -, ont été l’occasion d’imposer une série de « réformes structurelles » visant à déréguler le marché du travail, à accroître les profits et à protéger les hauts revenus. Tout s’est passé comme si la crise financière de 2008 avait permis l’accentuation et l’accélération du programme néolibéral. La supposée « recherche de la croissance » sert aujourd’hui encore de prétexte pour appliquer les mesures les plus régressives socialement, à augmenter les avantages accordés au capital, à passer les accords commerciaux internationaux les plus favorables aux grandes entreprises. Les explications chargées de rendre compte de cette radicalisation ne manquent pas. On peut distinguer parmi elles des thèses « idéologiques », « sociologiques », « économiques » : celles qui font du néolibéralisme une doctrine qui fonctionne par imposition massive d’évidences indiscutables, celles qui font plutôt ressortir l’extraordinaire déséquilibre dans les rapports de force entre les classes et enfin celles qui montrent que les formes du nouveau capitalisme mondialisé et financiarisé sont les ressorts « profonds » des politiques mises en œuvre. Trois types différents d’explication se dégagent qu’il nous faut examiner : le déni de réalité ; le déséquilibre croissant des forces en présence ; la logique intrinsèque du capitalisme contemporain.
1) Le déni de réalité
Comment expliquer que les détenteurs du monopole de la parole publique légitime, journalistes, éditorialistes, hommes politiques aient aussi rapidement occulté la crise, oublié ses facteurs et ses enchaînements, refoulé tout questionnement sur les risques d’une répétition du krach financier, fermé les yeux sur les souffrances endurées par la population et les effets politiques de la crise sociale ? Après un temps finalement assez bref d’hésitations quant à la conduite à tenir, accompagné de quelques autocritiques (on se rappelle le mea culpa d’Alan Greenspan devant les représentants américains), l’espace médiatique fut à nouveau submergé par un flot de messages identiques à ceux qui prévalaient avant la crise : il n’existe et n’existera qu’un seul système économique et ce système est fondamentalement sain. La continuation des politiques néolibérales serait donc due à la persistance de ce matraquage de la « pensée unique » des éditorialistes économiques, voire de la plupart des journalistes. Si l’on suit cette explication, les néolibéraux ont mené, par l’intermédiaire des medias, une guerre unilatérale qui leur a permis d’imposer une perception commune de la réalité (le sens commun de Gramsci). Ils n’ont pas gagné à proprement parler la « bataille des idées », car il n’y a jamais eu vraiment de « champ de bataille » entre des adversaires déclarés. Et ce ne sont d’ailleurs même pas des idées clairement exposées et articulées qui ont triomphé, car de telles idées auraient dû renvoyer à un référent dans le réel. Il s’agit plutôt d’une construction de la réalité perçue qui rend naturel, évident, fatal le cours des choses et expliquerait l’anesthésie des sociétés.
Cela pourrait tenir d’abord au fait que l’économie mainstream qui justifie ces politiques néolibérales est foncièrement autiste, comme l’ont montré depuis longtemps les « hérétiques » de la pensée économique1 . Il est frappant de remarquer que, malgré la faillite complète des thèses sur l’efficience parfaite des marchés, la théorie économique standard a été si peu entamée par cet échec et continue d’être archi-dominante dans les universités du monde entier. Lorsque certaines autocritiques sont devenues inévitables - on pense aux « erreurs » des économistes du FMI qui ont sous-estimé les effets multiplicateurs de l’austérité-, elles n’ont été suivies d’aucune révision des politiques désastreuses menées en Europe. En ce sens, les néolibéraux sont bien des « fondamentalistes », pour reprendre la formule de Stiglitz, enfermés dans le carcan d’une doctrine dogmatique qui les rend imperméables au réel. Cet enfermement volontaire pourrait bien tenir aussi au caractère révolutionnaire du néolibéralisme, sur lequel Pierre Bourdieu mettait l’accent. La « révolution conservatrice » néolibérale consistait, selon lui, à réaliser une utopie aux allures scientifiques, celle du marché autorégulé2 . Cette utopie a son dynamisme propre, ses effets d’emballement et d’aveuglement. Les échecs ne sont jamais que des insuffisances et des inachèvements dans l’application du modèle de société qui encouragent à « aller plus loin et plus vite » dans la réalisation du rêve utopique. En un mot, les néolibéraux sont des promoteurs d’une « révolution conservatrice permanente » immunisée contre toutes les épreuves du réel et qui ne voit dans les échecs que des raisons d’une radicalisation croissante.
2) Le déséquilibre croissant du rapport des forces
La crise n’est pas tant un facteur qui hâte la venue de la révolution, comme Marx l’a parfois pensé, qu’un moyen de renforcer le pouvoir des dominants parce qu’elle permet de transférer le coût de sa « résolution » (en réalité de sa perpétuation) sur les classes populaires et salariées. Inutile de voir là une stratégie délibérée, voire un complot. La crise permet de créer un volant de main d’œuvre disponible et une insécurité sociale générale qui disciplinent le salariat, le désorganisent, l’empêchent de résister à la démolition de ses acquis. Au fond la crise, même si elle n’a pas été délibérément provoquée, est devenue, une fois déclenchée, un formidable instrument qui sert les intérêts des plus forts. C’est la thèse selon laquelle la revanche des riches et des puissants leur fera toujours s’écrier : « Vive la crise ». Peut-être l’explication fait-elle une part trop grande à la programmation stratégique de la classe dominante, elle a néanmoins pour elle une certaine crédibilité historique. La lutte engagée par les plus riches et les détenteurs du capital pour rattraper le temps perdu, ou plus exactement pour regagner le profit perdu durant les « trente glorieuses », n’est pas terminée, elle durera autant que le permettra l’état très favorable du rapport de forces entre la classe dominante et la classe des salariés3 . La lutte que mène la classe dominante avec l’appui des oligarchies politico-bureaucratiques s’accentue à mesure que les classes dominantes gagnent du terrain, se renforcent, étendent leur domination sur les medias, les institutions, dans les esprits. La radicalisation néolibérale tient donc en premier lieu au fait que la classe riche n’a pas fini sa guerre d’agression contre les classes pauvres, sur tous les plans : privatisations, allégements fiscaux, augmentation des profits, baisse des « acquis sociaux », affaiblissement des services publics, précarisation de l’emploi, intensification du travail, augmentation du temps de travail (y compris le dimanche), etc. D’un point de vue sociologique, aucun sujet collectif ne s’est encore formé sur le mode et avec la puissance de l’ancienne classe ouvrière. La désyndicalisation ouvrière se poursuit sans qu’elle soit compensée par l’organisation et la mobilisation de nouvelles forces sociales. Bref, le néolibéralisme regardé comme l’expression doctrinale et le levier politique des classes dominantes n’est pas près de disparaître tant qu’il n’aura pas d’adversaires organisés munis d’un projet alternatif de société.
3) La logique intrinsèque du capitalisme contemporain
La troisième série d’explications de la radicalisation néolibérale, parfois d’inspiration marxiste mais pas toujours, combine deux facteurs : la dynamique de la domination du capitalisme financier et les effets auto-entretenus de la globalisation économique. Le principe de ce type d’interprétations est le suivant : le capitalisme contemporain poursuit une trajectoire autonome et puissante qui détermine les politiques menées, lesquelles ne sont jamais que des effets de mécanismes et d’enchaînements économiques qui ont une logique propre. Pour les unes, cette logique est à la fois celle du « toujours plus » du capital en général et celle d’un « toujours plus » financier très spécifique. La financiarisation de l’économie est un cannibalisme spéculatif qui dévore progressivement l’économie productive. Pouvant à l’occasion s’appuyer sur le Livre III du Capital, ce type d’explication montre que le capital fictif porteur d’intérêt s’émancipe de la production et vient parasiter à son profit la répartition de la plus-value, au point que pour maintenir un minimum d’investissement productif il faut peser de plus en plus sur les salaires et augmenter le taux d’exploitation4 . La mise en évidence du poids croissant de la rente dans la répartition du produit est une variante non marxiste de cette explication que l’on trouve chez Thomas Piketty par exemple5 . Cet aspect parasitaire du capitalisme contemporain n’est au fond qu’une des dimensions d’une globalisation qui ne concerne pas seulement les marchés financiers. La globalisation a accru la mobilité et la volatilité des capitaux, ce qui a mis en concurrence l’ensemble des conditions de valorisation du capital, et entre autres, le niveau des salaires, la protection sociale, la fiscalité des profits. Elle a créé une immense armée de réserve industrielle, tertiaire et intellectuelle à l’échelle de la planète. Elle a accentué les disparités d’atouts et de dynamisme des territoires (villes globales prospères/territoires périphériques abandonnés). Elle a non seulement mis en concurrence les salariats et les territoires, elle a aussi polarisé la main d’œuvre sur la chaîne de valeur désormais organisée à l’échelle mondiale entre les « cognitifs » et les exécutants taylorisés. Passées un certain seuil, cette concurrence entre pays et cette polarisation dans la spécialisation conduisent à des régressions sociales violentes et à des déficits commerciaux et budgétaires pour les pays les moins bien placés. Pour regagner en compétitivité « fiscale ou sociale », les dirigeants des pays capitalistes sont poussés à organiser une dévaluation interne en baissant salaires et protection sociale, et ceci du fait même qu’ils ne peuvent plus dévaluer la monnaie nationale du fait des contraintes financières que font peser sur eux les créanciers.
Ces explications sont séduisantes, elles contiennent toutes une part de vérité mais elles restent unilatérales et partielles. Elles ne parviennent pas à saisir l’originalité historique du néolibéralisme pour réduire à une seule dimension soit idéologique, soit sociologique, soit économique, un processus qui demande à être compris avant tout dans sa systématicité. Or à combiner les trois, on ne fait jamais qu’accoler trois explications hétérogènes sans parvenir à rendre compte de ce caractère systémique. Nous voulons dire par là que c’est dans l’articulation et la cohérence d’un système de règles et de d’institutions économiques, politiques, culturelles, sociales et subjectives qu’il faut désormais chercher à saisir cette originalité historique.
Un système hors-démocratie
Il convient de prendre au sérieux l’hypothèse selon laquelle nous sommes entrés dans un système social post-démocratique inédit dans l’histoire, qui a rompu avec le vieux système qui articulait capitalisme national, État social, démocratie libérale. Une certaine distribution des pouvoirs entre le « « politique », « l’économique » et le « social » s’était établie qui laissait aux forces politiques et sociales une marge d’action et un jeu d’initiatives et de propositions. Parmi ces forces, le syndicalisme participait à l’équilibre dynamique d’un capitalisme national régulé, tout en garantissant des avancées sociales et des progressions de salaires par la négociation et une conflictualité relativement instituée. Capitalisme et démocratie, parlementaire mais aussi en partie sociale, semblaient pouvoir se concilier jusqu’à un certain point. Avec le néolibéralisme, cette conciliation n’est plus à l’ordre du jour. Le néolibéralisme, par l’étendue de ses effets et manifestations, est un véritable système politico-économique dont il faut saisir l’originalité. Celle-ci tient d’abord à ce qu’il vise à vider de son contenu la démocratie sous sa double forme politique et sociale. Les politiques néolibérales, on s’en aperçoit mieux maintenant, ont obéi à une stratégie de « dé-démocratisation »6 , selon la formule de Wendy Brown, qui a conduit progressivement à l’établissement d’une situation dans laquelle la « souveraineté populaire » est destituée au profit des « forces de marché » dans l’orientation des choix politiques.
1) un principe de gouvernement
Pour le comprendre il faut revenir à ce qui constituait le problème stratégique pour les néolibéraux des années 50 aux années 70 : comment s’immuniser contre la démocratie « excessive » et « totalitaire » qui rendait les pays capitalistes « ingouvernables » ? Il ne s’agissait plus à leurs yeux de gérer à peu près pacifiquement une conflictualité sociale selon un « partage des bénéfices » qui pouvait faire illusion avec l’extension de la consommation de masse, mais de promouvoir à tous les niveaux un nouveau principe social et politique qui aurait une valeur et une force quasi-constitutionnelles capable de limiter les revendications populaires. Ce que la construction européenne assurera avec un grand succès à partir des années 80, comme on le montrera plus loin. Ce principe général est celui de la concurrence de marché, qui s’est inscrit peu à peu dans les règles du commerce international, dans l’organisation de la finance, dans les relations entre les pays, dans la gestion des services publics. C’est lui qui est au cœur du « consensus de Washington » comme c’est lui qui est au centre des traités de l’Union européenne.
Ce principe institutionnalisé définit un jeu qui a ses règles contraignantes. Une fois acceptées et cristallisées, c’est l’ensemble des politiques menées qui doivent obéir sans retour en arrière possible à la logique dite de « compétitivité ». L’absence d’ « option de sortie » tient à ce que les gouvernements se sont liés par des engagements constitutionnels comme en Europe, ou par des traités et accords commerciaux de toutes sortes qui ont acquis peu à peu le caractère de contraintes systémiques incontournables du fait, en particulier, de la surveillance exercée par les institutions de la « gouvernance mondiale » (OMC, FMI, Banque mondiale, etc.) et les agences de notation privées. C’est au fond comme si les gouvernements avaient produit un maillage de plus en plus serré de normes et de règles qui limitaient de facto pour eux toute possibilité de mener une politique qui ne serait pas guidée par l’impératif de compétitivité. Le système néolibéral se construit et se solidifie alors selon une dynamique auto-entretenue : les politiques de compétitivité diffusent la norme concurrentielle à tous les secteurs de la société, de l’économie et de l’État et cette norme prend le pas sur tout autre principe de vie en commun.
Le rêve hayekien d’une démocratie limitée est en passe de devenir réalité. Il y avait pour lui deux manières d’y parvenir : soit le coup d’État militaire à la chilienne, soit la voie dite « incrémentale », c’est-à-dire progressive, laquelle avait sa préférence. Hayek avait eu l’intuition que la domination effective des forces de marché devait passer par un processus de constitutionnalisation de l’ordre du marché. Sans doute ce processus n’a t-il pas correspondu à cette « découverte culturelle progressive » que les échangistes auraient pu faire dans la version idyllique du penseur autrichien. Il s’est développé par la mise en concurrence de tous contre tous, jusqu’à devenir une forme généralisée de subjectivité qui détruit les racines mêmes de la citoyenneté. Une fois parvenu à maturité, le système de normes qui régit les relations économiques et sociales tel qu’il a été produit par les gouvernements, prend bel et bien le pas sur toute décision que pourrait prendre un corps électoral supposé « souverain ». L’ordre du marché prévaut alors sur la démocratie. Le principe de concurrence, qui devient une obligation générale de compétitivité, prend alors le sens d’ un véritable « principe », au sens que donne Montesquieu à ce terme : la « passion » ou le « ressort » qui fait agir un type de gouvernement. On se rappelle que pour ce dernier chaque régime repose sur un principe qui le singularise : honneur pour la monarchie, vertu pour la république, crainte pour le despotisme. La concurrence est le principe politique du nouveau gouvernement néolibéral. Mais l’analogie s’arrête là. Le néolibéralisme ne constitue pas un nouveau régime politique qui viendrait s’ajouter à la typologie classique héritée d’Aristote : monarchie, aristocratie, démocratie, ou, comme chez Montesquieu, monarchie, république, despotisme. Il s’agit bien plutôt d’un « complexe » historique inédit, de caractère essentiellement normatif, tout à la fois politique, économique et juridico-institutionnel, qui a pour effet de rendre caduque la notion même de « régime politique » en remettant directement en cause l’autonomie des « pouvoirs publics » à l’égard des forces du marché.
2) Normes et acteurs
Le système néolibéral de normes concurrentielles a permis l’émergence de trois puissances politiques et économiques : les grandes entreprises, les acteurs financiers, l’oligarchie politico-bureaucratique. Ces trois puissances contrôlent les États par différents biais : les entreprises multinationales par leur pouvoir sur l’emploi et la croissance du fait du chantage aux investissements qu’elles peuvent réaliser ou non ; les acteurs financiers par les créances obligataires en tant qu’acheteurs de la dette publique ; et l’oligarchie politique par le rôle de commandement sur les bureaucraties nationales mises au service des deux premières puissances.
a) Les grandes entreprises
Le système néolibéral est caractérisé par la domination des grandes entreprises (giant corporations) sur les gouvernements, entreprises gouvernées elles-mêmes par des actionnaires strictement intéressés à la maximisation de la valeur de l’action et au montant du dividende7 . Plusieurs processus sont à l’origine de ce pouvoir politique : l’accroissement de taille des entreprises qui leur donne un pouvoir de marché et une influence sur l’emploi considérables ; leur extraterritorialisation, en particulier sur le plan fiscal, qui leur permet de mettre en concurrence les États eux-mêmes ; leur richesse accumulée, qui est mise au service du soutien aux partis politiques ; leurs contributions à la puissance des États capitalistes dans le monde (Etats-Unis, Europe, etc.). La dérégulation financière, la flexibilisation des marchés de l’emploi, l’allègement des impôts sur les profits du capital et les revenus des plus riches, obstacles mis à la réforme de la santé aux Etats-Unis ou à la taxe Tobin en Europe, freins multiples à la transition écologique, sont autant de résultats de l’action collective des grandes entreprises. L’un des plus importants moyens est le lobbying direct qui permet d’acheter les voix des représentants et d’orienter les campagnes électorales. L’autre est le chantage à la fuite des capitaux, à la grève de l’investissement, à la destruction de l’emploi. Ce pouvoir des grandes entreprises a été renforcé par les privatisations. Les entreprises privées se sont vu concéder des missions de service public dans de multiples domaines (télécommunications, informations, internet, recherche, autoroutes, santé, et même opérations militaires ou de police, etc.). Les grandes entreprises sont ainsi devenues des organisations politiques, exerçant des pouvoirs dominants sur les gouvernements. Les actionnaires trouvent dans la grande entreprise moderne une forme d’action collective particulièrement efficace pour s’introduire jusque dans le mécanisme de la décision politique et ainsi accroître leurs revenus et leurs patrimoines, et ceci par le moyen conjugué d’une triple domination : sur les salariés, sur les consommateurs, sur les contribuables.
b) les acteurs financiers
Les baisses d’impôts accordées aux classes dominantes et aux grandes entreprises, la grande tolérance envers l’évasion fiscale, à un moment où le chômage et le vieillissement impliquaient des dépenses sociales plus importantes, ont entraîné une croissance de la dette publique qui a littéralement explosé après 2008, lorsqu’il a fallu renflouer les banques et prendre des mesures de relance pour sauver certains secteurs. Comme l’a montré W. Streeck8 , le passage d’une crise de la dette privée à une crise de la dette publique a accéléré la mutation vers le nouveau système politique. Le centre de gravité du pouvoir, se trouve désormais dans les mains des créanciers des Etats, les fameux “marchés financiers”. Ce sont eux qui imposent des normes financières et politiques qui entrent en contradiction directe avec le financement des services publics. Les intérêts de la finance internationale imposent, via les agences de notation et le FMI, les choix politiques dans la mesure même où c’est la capacité de fonctionnement des Etats qui est en jeu. Mais là ne s’arrête pas ce pouvoir financier. Ce sont les Etats eux-mêmes qui ont intégré le risque systémique en rachetant les titres de la dette privée et font donc assumer aux contribuables la responsabilité des créanciers. Les relations internationales entre Etats ont pris le relais des rapports entre créanciers privés et États. C’est le sens de toutes les dispositions prises par le Conseil européen depuis 2008. Pressions, contrôles et sanctions de toutes sortes envers les pays les plus endettés sont désormais institutionnalisés. La priorité absolue donnée au remboursement des dettes et l’interdiction absolue de leur restructuration justifient l’austérité généralisée, aussi catastrophique que soient ses effets. Bref, ce sont les impératifs des marchés financiers qui ont refaçonné les institutions et dispositifs politiques en faisant passer la protection des détenteurs de la « dette souveraine » avant tout impératif social. Dans un tel système, ce sont les engagements auprès des créanciers qui ont la priorité sur la volonté des citoyens.
c) Les oligarchies politiques
La prise de contrôle des instances de décision politique par des groupes et des individus étroitement liés aux lobbies économiques et financiers est sans doute l’un des aspects les plus frappants du système néolibéral. Le remplacement brutal des gouvernants en Italie ou en Grèce par des « techniciens » dirigés par d’anciens banquiers de Goldmann Sachs est le signe de cette emprise de plus en plus directe des marchés financiers. De façon plus générale, c’est l’ensemble de l’appareil et du personnel politique qui s’est transformé. Loin de constituer un contrepoids aux pouvoirs des grandes entreprises et des créanciers, les oligarchies politiques sont devenus les relais institutionnels indispensables dont la principale fonction est d’importer dans le champ politique et dans les structures bureaucratiques les normes et les impératifs du nouveau capitalisme. Ce qui se fait en faisant supporter le coût de la crise du capitalisme financier aux salariés, aux contribuables et finalement à la très grande majorité de la population. La rhétorique « nationale » dont usent et abusent les dirigeants politiques voile le fait que le pouvoir de production des normes a été transféré à des organismes intergouvernementaux ou internationaux non élus, fonctionnant hors de tout contrôle de la part des citoyens. C’est notamment le cas de la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne), mise en place à la suite d’un accord intergouvernemental, dont les fonctionnaires ont élaboré pour la Grèce un programme de gouvernement complet en exerçant sur les ministres grecs un véritable chantage au crédit. L’opposition droite-gauche est elle-même vidée de tout contenu depuis que les partis de la « social-démocratie » se sont pliés au nouvel ordre par « réalisme » et ainsi coupés des couches populaires qui avaient longtemps constitué leur soutien électoral. Ces cercles dominants, quelle que soit leur « couleur » politique, mènent les politiques inégalitaires influencées et parfois purement et simplement dictées par les groupes patronaux. Cela conduit à l’appauvrissement des classes populaires et, au-delà, des classes moyennes qui étaient les piliers de la démocratie parlementaire. Corruption, conflit d’intérêts, « revolving doors, » et plus généralement fusion sociologique croissante du monde des affaires et du monde politique caractérisent ce système postdémocratique. Désormais c’est cette triple alliance des oligarchies bureaucratiques et partidaires, des grandes entreprises et des fonds prêteurs qui ont la main sur l’essentiel des orientations politiques. Il en découle que la démocratie électorale est complètement désactivée, réduite qu’elle est à une illusion dans un théâtre d’ombres où c’est toujours la politique de la « triple alliance » qui a le dernier mot.
3) Les règles européennes
Dans ce système normatif, une place toute particulière revient indiscutablement à la logique de l’intégration européenne telle qu’elle s’est affirmée traité après traité. En effet, ces traités ont constitutionnalisé trois « règles d’or » : la stabilité monétaire, l’équilibre budgétaire, la concurrence libre et non faussée. Cet édifice a été récemment couronné par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) qui prévoit des sanctions immédiates pour toute violation des dites règles. Selon le dogme de l’ordolibéralisme, ces règles définissent une « constitution économique » qui doit s’inscrire dans le droit positif des différents Etats européens. Or cette « constitution » est censée remplir la même fonction qu’une constitution politique, notamment en garantissant la « séparation des pouvoirs » dans l’ordre économique. Il en découle la consécration de l’indépendance de la Banque centrale : il n’appartient pas aux Etats de décider de la politique monétaire, mais il leur revient d’appliquer une politique décidée par la Banque. On mesure la forfaiture politique ainsi perpétrée : alors que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs doit permettre d’« arrêter le pouvoir par le pouvoir », en interdisant en particulier que le pouvoir de faire les lois se confonde avec celui de les exécuter, ce même principe, arbitrairement transposé dans l’ordre économique, se voit chargé de justifier le fait que la politique monétaire soit soustraite à toute délibération et à toute décision publiques. En d’autres termes, il s’agit de subordonner irrévocablement le pouvoir politique à un « pouvoir économique » supposé gardien de l’intérêt général en raison de son impartialité et de son indépendance à l’égard des citoyens organisés, ce qui revient à enchaîner tout pouvoir politique élu et soumis à l’exigence d’une reddition de comptes aux décisions d’un autre pouvoir, politique lui aussi quoiqu’il en dise, mais non élu et incontrôlable. En vertu d’un tel tour de force, on élève la « constitution économique » au-dessus de toute alternance électorale en sommant tout nouveau gouvernement de « respecter les engagements » auxquels tout gouvernement, quelle que soit la majorité politique du moment, est tenu9 . Le cas de la Grèce est emblématique : car si l’Eurogroupe et la Troïka ont accordé une extension de 4 mois du programme de financement, c’est en insistant sur la continuité du programme issu de l’accord de 2012 qui devait continuer de s’appliquer coûte que coûte, en dépit des souffrances infligées au peuple grec.
Conclusion
Alors que les signes s’accumulent d’une nouvelle phase économique et financière chaotique, tout semble indiquer que nous nous dirigeons de façon accélérée vers un nouveau système caractérisé par l’enfermement des sociétés dans un corset disciplinaire de règles et de contraintes dont elles auront la plus grande difficulté à se débarrasser, spécialement dans un contexte marqué par un affaiblissement des forces organisées du salariat. Or le système néolibéral ne peut être enrayé et contenu, a fortiori déconstruit et surmonté, que par des mouvements qui se situent en dehors du jeu de la « triple alliance », c’est-à-dire en dehors du jeu de l’État néolibéral. Ce qui supposerait une forte mobilisation des populations aujourd’hui résignées ou tentées par la voie xénophobe.
Dans de telles conditions, le seul horizon réaliste est un affrontement de plus en plus dur entre la finance (c’est-à-dire les propriétaires de la dette) et la population. Mais jusqu’où pourront aller les gouvernements dans la guerre menée par délégation contre leur propre population ? Et jusqu’à quand la population va-t-elle supporter ces agressions sans réagir très brutalement et dans un sens que l’on ne peut préjuger ?
|
![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037